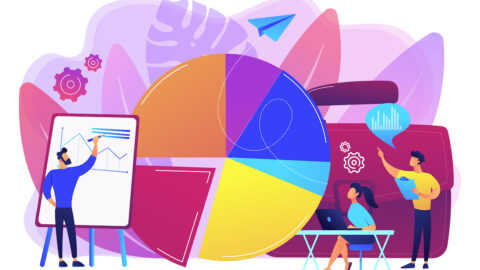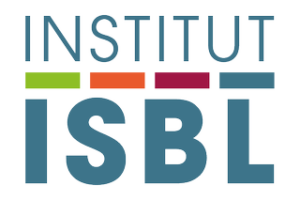Question orale avec débat n° 0034A de Mme Marie-France Beaufils (Indre-et-Loire – CRC-SPG) publiée dans le JO Sénat du 16/04/2009 – page 925 : Madame Marie-France Beaufils attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les problématiques de la taxe professionnelle.
Maintes fois, depuis sa création en 1976, la taxe professionnelle a fait l’objet de modifications législatives conduisant à rendre son économie générale de moins en moins évidente et de plus en plus opaque pour les élus locaux.
La commission Balladur sur la réforme des collectivités territoriales vient d’ajouter, à l’occasion de la publication de ses premières conclusions, à la perplexité et aux interrogations sur le devenir de cette ressource essentielle pour les budgets locaux ( plus de 40 % de leurs recettes fiscales propres ).
Les plus récentes déclarations du Président de la République, évoquant la suppression de la taxe professionnelle, ont d’ailleurs ajouté à l’inquiétude maintes fois exprimée des associations d’élus locaux.
Elle l’interroge donc sur le bilan des modifications intervenues, leur impact sur les finances locales et la vie économique, sur les orientations que le Gouvernement entend définir quant au devenir de la taxe professionnelle, à la concertation menée sur ce sujet et aux conséquences de toute évolution sur les futures politiques locales.
Réponse du Secrétariat d’État chargé de l’industrie et de la consommation publiée dans le JO Sénat du 11/06/2009 – page 5944
Séance du 10 juin 2009 (compte rendu intégral des débats)
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la situation économique dans laquelle nous nous trouvons et qui, selon l’INSEE, a commencé à se dégrader dès le premier semestre de 2008, est devenue un nouveau prétexte pour remettre en cause des équilibres sur lesquels la France a bâti son modèle social.
En effet, à écouter le Président de la République, en quête de l’improbable refondation du capitalisme, le moment serait venu, du fait de la crise, de mettre un terme à l’existence de la taxe professionnelle, considérée comme une incongruité juridique et fiscale dont nous serions les derniers dépositaires en Europe.
Il faudrait, sous le prétexte des contraintes de la mondialisation et au nom de la compétitivité de nos entreprises, alléger encore plus la contribution de celles-ci au financement des collectivités locales.
Toutefois, dans ces arguments qui sont assenés, il n’est jamais question des avantages que tirent ces mêmes entreprises de la mondialisation. En fait, on ne se demande jamais qui en bénéficie réellement. Les salariés ? Certainement pas, non plus que l’assise économique de la France ! Non, les véritables bénéficiaires, il faut plutôt les chercher du côté des actionnaires et des dirigeants !
Cette démarche tendant à supprimer la taxe professionnelle accompagne les nombreuses dispositions qui visent à alléger l’impôt sur les sociétés et, par là même, à rendre les entreprises de moins en moins contributrices à la charge commune. Comme si elles n’avaient pas besoin des dépenses collectives pour assurer leur développement !
À dire vrai, tel qu’il est posé, le débat est pour le moins biaisé.
On explique à chacun des habitants de ce pays que, pour sortir de la crise, il faut encore alléger l’imposition des entreprises, au moment même où les ménages constatent, pour leur part, les effets de la modération et de la stagnation salariale, la persistance des prélèvements fiscaux sur la consommation et la hausse des impôts locaux : cela a tout de même de quoi laisser rêveur, mes chers collègues !
Cette mesure a été présentée par le Président de la République comme un outil de relance économique, mais nous nous interrogeons sur son efficacité, sans doute parce que, instruits par l’expérience, nous nourrissons quelques doutes sur les politiques d’allégements fiscaux et sociaux.
Je ne sais ce que le concept d’« entreprise citoyenne » dont on nous rebattait les oreilles il y a quelques années, deviendra dans ce schéma.
Quoi qu’il en soit, une première série de questions mérite d’être posée, et elle est essentielle dans ce débat : les mesures prises depuis vingt ans afin de réduire le poids de la taxe professionnelle dans les comptes des entreprises ont-elles, oui ou non, porté leurs fruits ? Quel bilan, quelle analyse critique ont été réalisés ? Un rapport sur les emplois créés, les investissements supplémentaires réalisés dans ces activités économiques a peut-être échappé à notre attention, mais cela m’étonnerait…
L’une des grandes faiblesses du discours du Président de la République sur la suppression de la taxe professionnelle, c’est qu’il ne tient pas compte de l’histoire.
Avec l’instauration, dans le cadre de la loi de finances pour 1987, de l’allégement transitoire de 16 % sur les bases imposables, nous avons connu le premier moment clef de la mise en cause de l’équilibre de la taxe professionnelle.
Et l’on sait fort bien ce qu’est devenue la dotation destinée à compenser, pour les collectivités locales, les effets de cet allégement dit « transitoire ». L’incidence de ce dernier doit être mesurée de deux manières : à travers son coût pour l’État, en tenant compte bien entendu des sommes qui sont revenues dans ses caisses par le biais de l’impôt sur les sociétés, et à travers son coût pour les collectivités locales, après déduction du montant de la compensation perçue, naturellement.
On peut estimer que, au cours de la période d’existence de l’allégement transitoire, ce dispositif a coûté à l’État de 60 milliards à 80 milliards d’euros, en valeur de 2009. Il faut déduire 20 milliards à 25 milliards d’euros au titre des recettes de l’impôt sur les sociétés, mais ajouter le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Or celle-ci, comme nous l’observons depuis 1995, sert de variable d’ajustement aux dotations budgétaires, ce qui n’était nullement sa fonction au départ. Je rappellerai que, pour 2009, cette réduction a été portée à 27 %.
Deux chiffres permettent de résumer la situation.
À la fin de 1995, on promulguait une loi de finances prévoyant de consacrer plus de 17,8 milliards de francs, c’est-à-dire, en valeur actuelle, quelque 2,72 milliards d’euros – j’insiste sur ce chiffre ! – à la compensation de la taxe professionnelle. Dans la loi de finances pour 2009, ce montant s’établit à 582 millions d’euros, soit cinq fois moins en euros courants, et la réduction est évidemment encore plus sensible en euros constants ! Cette évolution s’est produite en moins d’une quinzaine d’années, ce qui, bien sûr, n’est pas neutre pour toutes les communes qui ont été privées de cette recette.
Une autre mesure prise au cours de l’histoire de la taxe professionnelle est la suppression de la part imposable des salaires.
On connaît le processus mis en œuvre : suppression progressive par abattement sur la valeur retenue des salaires et compensation quasi intégrale, avant l’intégration de celle-ci dans la dotation globale de fonctionnement.
En 2003, dernière année où la compensation était individualisée, l’État consacrait 9 033 millions d’euros à cette charge. La dotation globale de fonctionnement, pour sa part, représentait un ensemble de 18,9 milliards d’euros. En 2004, la fusion des deux éléments et la création de la dotation globale de fonctionnement des régions permettait de dépasser les 30 milliards d’euros. En 2009, la progression globale de la dotation était fixée aux alentours de 40,8 milliards d’euros, cette évolution générale n’ayant plus aucun lien avec la réalité des bases imposables théoriques.
Depuis 2004, en effet, il est évident que, année après année, le décalage entre la dotation budgétaire perçue et la réalité des produits fiscaux désormais abandonnés s’accroît, ce qui finit par coûter cher et pose une question récurrente : toutes les réformes de la taxe professionnelle, entre changements d’assiette et plafonnements divers, ont-elles atteint les deux impérieux objectifs qu’elles s’étaient fixés, à savoir la relance de l’emploi et celle de l’investissement ?
La réponse à cette question nous est peut-être fournie par M. Jean Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, dans son intéressant rapport sur le partage de la valeur ajoutée, même si, bien évidemment, ce n’était pas l’objet premier de ce document.
Ce rapport rappelle quelques données essentielles.
Tout d’abord, le mouvement de défiscalisation engagé en 1985 et accentué par la désindexation des salaires a conduit à redresser le taux de marge des entreprises et à l’installer durablement autour de 30 %. L’élévation de ce taux masque toutefois certains handicaps pour la progression globale de la valeur a
joutée. En particulier, le développement de l’emploi faiblement rémunéré, souvent précaire et peu qualifié, conduit à réduire la capacité de progression de la valeur ajoutée. A contrario, la part déclinante des emplois qualifiés joue désormais contre la croissance et la qualité de la production comme contre la productivité.
À force de jouer l’incitation aux bas salaires contre le développement de la formation qualifiante, on aboutit à dégrader le tissu économique, ainsi qu’il en va toujours lorsqu’on se contente d’une vision à court terme.
Corrélativement, la part des salaires, cotisations sociales comprises, s’est progressivement réduite dans la valeur ajoutée. Aujourd’hui, la part des cotisations sociales dans la masse salariale globale est de plus en plus marquée, mais celle-ci est au même niveau qu’en 1970 ! Et l’emploi ne s’est pas durablement ni réellement amélioré. Ainsi en est-il dans l’industrie qui, ces dernières années, n’a cessé de perdre des emplois, les entreprises préférant faire appel à des personnels non permanents, par le recours à l’intérim.
Du reste, on voit bien que, dans cette période de crise, les salariés sous contrat d’intérim sont les premières victimes ; ils ne bénéficient aucunement des plans de restructuration engagés.
Enfin, la défiscalisation, marquée par la baisse de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou de la taxe professionnelle a conduit à un accroissement sensible de la part de la richesse créée par le travail, mais consacrée à la rémunération du capital. C’est ce qu’indique très simplement le rapport Cotis quand il précise que la part destinée à la rémunération des actionnaires augmente ces vingt dernières années, tandis que celle qui est dévolue aux investissements diminue, avec tous les risques que cette évolution fait courir au tissu industriel.
L’existence des entreprises installées dans notre pays a ainsi connu, depuis vingt ans, plusieurs phases.
L’apport de la défiscalisation a tout d’abord, parallèlement à un mouvement de réduction des taux d’intérêt, conduit au désendettement et à la reconstitution des fonds propres. Puis, pour financer l’investissement, les entreprises ont fait de plus en plus souvent appel à des capitaux levés sur les marchés, dont la gourmandise est telle que la rémunération des capitaux en question a consommé une part croissante des bénéfices d’exploitation.
Ce processus ne concerne fondamentalement que les entreprises de grande taille, cotées sur les marchés financiers et faisant appel public à l’épargne. Toutefois, il n’épargne pas vraiment les PME, pour lesquelles la période a été marquée par deux processus clefs.
D’une part, l’intégration capitalistique dans des groupes a conduit non seulement à la mise en place des outils juridiques de « remontée financière » des profits des filiales vers la tête des groupes, mais aussi d’exigences de « performance » incompatibles avec le maintien de la rémunération des salariés, qui sont ainsi les premiers à payer le prix de cette évolution.
D’autre part, s’agissant des PME restées indépendantes, l’intégration de plus en plus forte en qualité de sous-traitantes, avec la pratique de contrats aux conditions léonines, a fait, là encore, remonter vers le donneur d’ordre l’essentiel de la valeur ajoutée.
Les résultats, nous les connaissons, mes chers collègues : fragilisation de nos PME et de l’emploi, fuite en avant perpétuelle vers le moins-disant social et fiscal.
Chacun ici sait que les principaux bénéficiaires de la baisse de l’impôt sur les sociétés sont les grands groupes, qui ont fait de l’allégement des cotisations sociales sur les bas salaires un véritable outil de gestion et qui « font leur miel » de la réduction de la taxe professionnelle.
Une éventuelle suppression, unilatérale ou presque, de la taxe professionnelle ne changera rien à cette répartition des avantages fiscaux comparatifs : ce seront les mêmes qui tireront le plus grand profit de ces choix.
Ce qui est nécessaire aujourd’hui, après plus de trente ans de vie de cet impôt, c’est d’en mesurer l’efficacité au vu de l’évolution de l’activité économique depuis 1976, date de sa création. On sait que l’économie, malheureusement, a pris une dimension financière qui était totalement absente des bases de calcul de l’époque.
L’une des critiques que ses opposants adressent le plus souvent à notre taxe professionnelle, c’est de n’avoir aucun équivalent en Europe, ce qui suffirait pratiquement à la condamner, au nom d’une harmonisation fiscale implicite et qui, d’ailleurs, n’est toujours pas à l’ordre du jour, le sacro-saint principe de subsidiarité laissant chaque État européen maître de la définition de sa fiscalité et des composantes de celle-ci. Que je sache, tout ce que fait l’Europe en la matière, c’est encadrer l’application des droits indirects, et non décider de la liste exhaustive des impositions de toute nature que peuvent instaurer les États. On ne s’attaque pas aux principes ni à l’architecture : on ne fait que limiter l’application de telle ou telle règle fiscale.
Le choix de la France de financer une bonne part de l’action des collectivités territoriales par le biais de l’impôt local n’est pas condamnable en soi, bien au contraire. Je pense même qu’il s’inscrit tout à fait dans l’esprit de nos textes constitutionnels, la Déclaration de 1789 exigeant de chacun qu’il contribue à la dépense publique en fonction de ses capacités.
Ce choix garantit aux collectivités locales une certaine autonomie, laquelle, ne l’oublions pas, a d’ailleurs été consacrée par la révision de la Constitution de 2003. Il leur permet d’assumer les compétences et les missions qui leur sont confiées et dont les entreprises bénéficient, à travers les infrastructures, pour l’essentiel, mais aussi à travers les services de qualité mis à la disposition des salariés et de leurs familles.
D’autres pays, plus décentralisés, ont fait des choix différents, qui passent notamment par le recours au partage du produit des impôts d’État.
Pour en revenir à notre taxe professionnelle, plutôt que de l’attaquer sans rémission, ce qui, à force de correctifs, amènerait l’actuel gouvernement à la réduire quasiment à néant, il nous semble, et c’est l’objet de cette question orale avec débat, qu’il faut plutôt réfléchir à son évolution, à sa modernisation.
Devons-nous, comme le Président de la République semble nous y inviter, procéder à l’exclusion définitive des investissements de l’assiette de cette imposition, ce qui la réduirait à une sorte de taxe foncière sur les activités économiques ?
Faut-il, en ce sens, mettre en avant la taxe carbone, cette imposition indirecte appelée à être essentiellement supportée par le consommateur final, sans lien clairement établi avec le territoire, et en répartir le produit pour compenser la mesure précitée ?
Ou faut-il plutôt réfléchir à l’évolution de l’assiette de la taxe, à l’importance et à la pertinence des correctifs qui y sont apportés, et trouver les voies et moyens d’une réforme participant de deux objectifs, à savoir, d’une part, assurer aux collectivités locales les moyens financiers de leur action et, d’autre part, rétablir entre les entreprises contribuables un traitement équitable au regard de l’impôt ?
Permettez-moi de rappeler que, avant le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, les services de l’État nous avaient permis de mesurer – ils répondaient à la sollicitation que je leur avais adressée en tant que rapporteur de la commission des finances – le poids de la taxe professionnelle
selon les activités économiques. Nous avions ainsi appris que, en 2004, le secteur financier ne consacrait que 1,7 % de la valeur ajoutée produite pour payer la taxe professionnelle, le BTP 1,9 %, le commerce 2,3 % et l’énergie 5,6 %.
Monsieur le secrétaire d’État, ne pensez-vous pas que l’intégration de la richesse financière dans les bases d’imposition serait efficace non pas seulement pour rétablir l’équité des entreprises face à l’impôt, mais aussi pour améliorer la vie économique elle-même ?
Ne serait-ce pas une bonne façon de combler le besoin de financement des collectivités territoriales pour leur permettre de répondre aux attentes des populations et des activités économiques, et aussi de faire face aux obligations de plus en plus nombreuses qui leur sont transférées ?
Les collectivités locales sont en attente d’une visibilité plus grande quant à leurs ressources. Vous savez, monsieur le secrétaire d’État, que la taxe professionnelle représente une ressource décisive dans leurs budgets. Vous savez également que l’intercommunalité a été essentiellement fondée sur une taxe professionnelle unique pour son financement.
Tels sont les points qui nous semblent être au cœur de ce débat dont nous avons souhaité la tenue, afin de pouvoir avancer sur cette question, primordiale selon nous, pour la vie de nos collectivités. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)